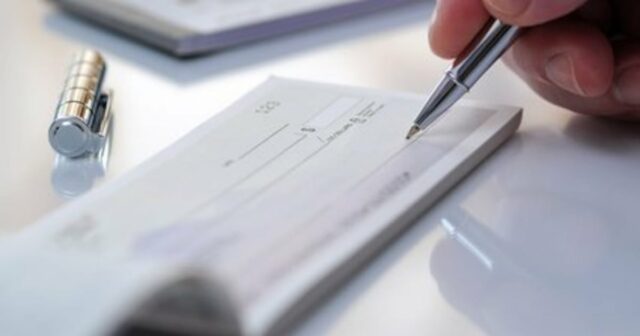La réforme du régime juridique du chèque au Maroc
Le gouvernement vient d’adopter le projet de loi n°71.24, marquant une réforme majeure du régime juridique du chèque au Maroc. Cette réforme, très attendue, vise à désengorger les tribunaux et à privilégier le règlement amiable des incidents de paiement plutôt que la sanction pénale. Mais au delà de l’assouplissement légal, certains s’interrogent sur la portée réelle de cette réforme et sur l’avenir du chèque comme instrument de paiement sûr. Dans un entretien accordé au magazine Challenge, Abdelhaq Bolgot, avocat agréé près la Cour de Cassation de Casablanca, affirme que le projet de loi introduit plusieurs changements significatifs.
Des changements significatifs introduits par la réforme
«La première nouveauté concerne le rôle actif de la banque tirée. Celle-ci doit, dans un délai de deux jours après un refus de paiement pour défaut de provision, enjoindre au titulaire du compte de restituer toutes les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires, et prouver l’envoi de cette injonction», explique-t-il. Le texte réduit également de dix à cinq ans l’interdiction pour l’émetteur de chèques d’en émettre de nouveaux, sauf pour les chèques certifiés ou destinés au retrait de fonds.
La réforme opère aussi une distinction claire entre infractions simples et infractions frauduleuses. Pour les premières, telles que l’absence ou l’insuffisance de provision, la peine d’emprisonnement est désormais comprise entre six mois et deux ans, avec une amende de 5.000 à 20.000 DH. Les infractions plus graves (falsification, usage de faux ou remise d’un chèque à titre de garantie) entraînent de un à trois ans de prison et des amendes allant de 20.000 à 50.000 DH. Le projet de loi introduit par ailleurs des exceptions notables. L’émission d’un chèque entre conjoints, ascendants ou descendants du premier degré n’est plus considérée comme une infraction pénale, de même que celle effectuée par un conjoint dans les quatre années suivant la dissolution du mariage.
Un mécanisme de régularisation financière
La réforme introduit également un mécanisme de régularisation financière, écrit Challenge. Le paiement du chèque ou le désistement de la plainte met fin aux poursuites pénales moyennant le versement d’une amende de 2% du montant du chèque, contre 25 % auparavant. «Cette réduction spectaculaire rend la régularisation plus accessible et devrait encourager davantage d’émetteurs à régler leurs chèques impayés pour réintégrer le circuit bancaire», souligne Maître Bolgot. Cependant, il avertit que «cette baisse massive pourrait aussi banaliser le manquement et affaiblir le caractère dissuasif du dispositif. Certains pourraient être tentés de prendre le risque d’émettre des chèques sans provision, sachant que la régularisation leur coûtera désormais très peu».
Les implications de la réforme sur la valeur symbolique du chèque
Au-delà de l’aspect pratique, la réforme soulève des questions sur la valeur symbolique et la force contraignante du chèque. «Pendant longtemps, le chèque était perçu comme un engagement fort, garantissant au bénéficiaire un paiement immédiat et certain», rappelle l’avocat. Or, avec la possibilité d’un délai de 30 jours pour régulariser sa situation –prolongeable avec l’accord du bénéficiaire– et la diminution des peines, le chèque perd une partie de sa force morale et de son rôle de garantie immédiate. «Dans les faits, le chèque devient parfois un paiement à terme, voire un crédit déguisé», estime-t-il.
Les propositions d’amélioration de Maître Bolgot
Pour protéger les bénéficiaires tout en favorisant la régularisation, la réforme maintient certaines sanctions. Les infractions graves restent punies, et les banques conservent un rôle actif dans la notification des incidents. Maître Bolgot propose cependant des pistes d’amélioration: «il serait opportun de prévoir une amende plus élevée en cas de récidive, d’accélérer le traitement des plaintes et de développer des mécanismes de médiation bancaire. Ces ajustements aideraient à maintenir un équilibre entre confiance et responsabilité».